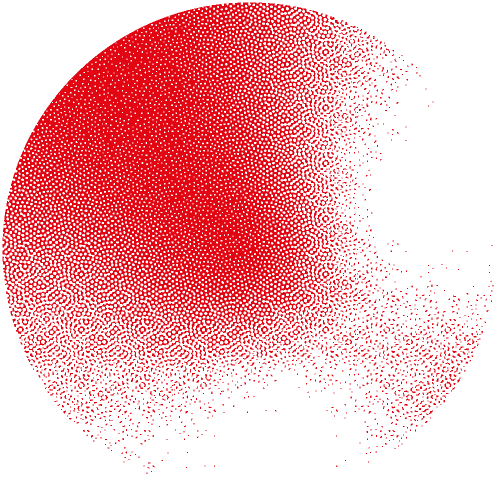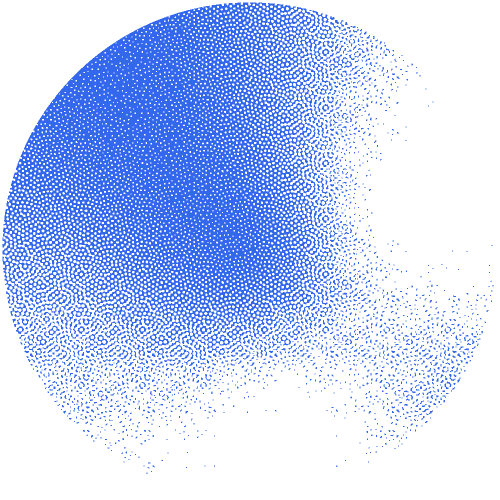Jakob Ruess – Co-lauréat du prix SIB 2012 du meilleur article de fin d'études en bioinformatique
Jakob Ruess a reçu ce prix conjointement avec Christoph Zechner, coauteur de la publication « Moment-based inference predicts bimodality in transient gene expression » (L'inférence basée sur les moments prédit la bimodalité dans l'expression génique transitoire). Cet article s'inscrit dans le cadre des études supérieures de Jakob au sein de l'équipe de John Lygeros à l'ETH Zurich.
Jakob occupe désormais un poste permanent de chef de groupe en France. Son équipe est affiliée à l'Institut national de recherche en informatique et mathématiques appliquées (INRIA) et au Centre de bioinformatique, biostatistique et biologie intégrative (C3BI) de l'Institut Pasteur à Paris. L'un des principaux objectifs des recherches de Jakob est le développement de modèles mathématiques pouvant être utilisés pour représenter, comprendre et, à terme, contrôler la dynamique des systèmes biologiques. Pour en savoir plus sur ses recherches, consultez la page web du groupe de Jakob et lisez notre interview.
À propos des SIB Bioinformatics Awards et de notre série d'entretiens « Rencontre avec les anciens lauréats des SIB Awards »
Lancés en 2008 dans le but de distinguer de jeunes bioinformaticiens en Suisse, les SIB Bioinformatics Awards ont depuis parcouru un long chemin : d'un seul prix national à trois prix différents aujourd'hui, récompensant 1) des bioinformaticiens internationaux en début de carrière (SIB Early Career Bioinformatician Award), 2) l'excellence au sein de la communauté suisse des doctorants (SIB Best Swiss Bioinformatics Graduate Paper Award) et 3) des ressources bioinformatiques innovantes (SIB Bioinformatics Resource Innovation Award). Au fil des ans, 21 prix ont été décernés, récompensant neuf lauréats pour leur début de carrière exceptionnel, dix étudiants diplômés pour l'excellence de leurs publications et deux ressources bioinformatiques pour leur caractère innovant.
En 2019, les SIB Bioinformatics Awards seront décernés pour la10e fois, ce qui sera l'occasion de retrouver les anciens lauréats et de leur demander où ils en sont dans leur carrière : cette interview fait partie d'une série qui vous invite à rencontrer les anciens lauréats des SIB Bioinformatics Awards.
À quel stade de votre carrière étiez-vous lorsque vous avez reçu le prix SIB ? Qu'avez-vous ressenti ? Quel était le principal centre d'intérêt de vos recherches à cette époque ?
J'étais doctorant et venais tout juste de terminer ma première année ! Naturellement, recevoir un prix aussi prestigieux si tôt dans ma carrière était incroyable. Cela m'a vraiment motivé et a certainement influencé ma décision de poursuivre une carrière universitaire, d'autant plus que j'en avais la possibilité. Le prix récompensait un article dans lequel nous avions développé une méthode permettant de déduire des modèles cinétiques stochastiques à partir de données d'expression génétique unicellulaire, et utilisé cette méthode pour caractériser la variabilité intercellulaire dans la réponse au stress osmotique chez la levure. Ce que je fais aujourd'hui reste très similaire à ce type de travail à bien des égards, mais la biologie évolue si rapidement que les défis changent et se renouvellent sans cesse.
Quels sont vos domaines de recherche actuels ?
Parmi les « trois B » du C3BI, mon travail correspond le mieux à la « biologie intégrative ». J'ai une formation en statistiques et en théorie des probabilités, mais je ne m'intéresse pas particulièrement aux « grands ensembles de données » et à l'« apprentissage automatique », qui sont des tendances actuelles en bioinformatique. Ce qui me motive vraiment, c'est la fascination de développer des modèles mathématiques qui nous permettent d'expliquer et de simuler le fonctionnement dynamique de la vie, et d'utiliser ces modèles dans un contexte de biologie synthétique pour concevoir nous-mêmes des systèmes vivants. Pour l'instant, cela n'est réalisable de manière réaliste qu'à petite échelle, c'est pourquoi nous nous concentrons généralement sur l'étude de certains processus biochimiques spécifiques à l'intérieur des cellules. Par exemple, nous travaillons actuellement à l'utilisation de processus stochastiques pour modéliser des réseaux génétiques synthétiques simples tels que le « toggle switch » ou le « repressilator », des réseaux simples dans lesquels les gènes sont soit actifs (activés), soit inactifs (désactivés). Ce qui est vraiment formidable, c'est que nous disposons de notre propre laboratoire de biologie à l'Institut Pasteur et d'étudiants qui peuvent construire de tels réseaux afin de générer des données détaillées sur leur dynamique. Récemment, nous avons également commencé à automatiser nos plateformes expérimentales. Cela peut sembler n'être qu'un simple défi technique, mais si vous y réfléchissez un peu plus et que vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec une plateforme de microscopie intelligente et autonome, capable par exemple d'induire par optogénétique (ndlr : à l'aide de la lumière) l'expression de gènes dans des cellules individuelles et de la mesurer, vous vous rendez compte qu'un tout nouveau monde d'expériences possibles s'ouvre à vous. La plateforme cesse d'être un simple dispositif permettant de mener votre expérience et devient une interface permettant d'interagir avec les cellules. Je sais que cela ressemble un peu à de la science-fiction, mais l'idée est vraiment de comprendre la biologie en développant des programmes informatiques qui communiquent avec les réseaux génétiques en temps réel. Ce sera probablement l'une de mes principales orientations dans les années à venir, si je parviens à trouver des étudiants ou des post-doctorants ambitieux qui n'ont pas peur de se lancer dans un domaine scientifique aussi nouveau.
Selon vous, quelle est la découverte la plus fascinante rendue possible par la bioinformatique ?
Je ne voudrais pas mettre en avant une découverte en particulier. Ce qui nous fait vraiment avancer, c'est le flux de la science dans son ensemble, et la bioinformatique est l'un des moteurs qui alimentent ce flux. À mon sens, penser en termes de résultats révolutionnaires découle de notre désir humain de catégoriser et de quantifier les choses, mais cela ne rend pas vraiment justice au processus scientifique réel.
Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre ?
Honnêtement, je pense que devenir scientifique signifie aussi qu'il devient de plus en plus difficile de séparer clairement le temps de travail et le temps libre. Le temps que j'ai passé à répondre à cette question est-il du temps de travail ou du temps libre ? Je répondrai donc en disant que lorsque je ne suis pas assis à mon bureau, j'aime discuter autour d'un déjeuner, d'une bière ou d'un café de l'état du monde sur le plan scientifique, politique, sociétal, écologique (et tout ce qui s'y rapporte) avec mes collègues et amis qui viennent des quatre coins de la planète et qui ont souvent des opinions très divergentes. Dernièrement, je lis aussi pas mal de livres en français, car après tout, il est utile d'apprendre la langue du pays dans lequel on vit. Quand je pars en vacances, j'essaie généralement d'aller dans un endroit calme pour échapper un moment à l'agitation parisienne. Malheureusement, les Alpes sont un peu plus loin qu'elles ne l'étaient quand je vivais en Suisse.
Un message pour la future génération de bioinformaticiens ?
En science en général, et peut-être en biologie et en bioinformatique en particulier, certains sujets sont toujours très tendance. Il n'y a rien de mal à ce qu'un sujet soit tendance. Il y a généralement une bonne raison à cela. En bioinformatique, c'est souvent parce qu'un certain type de données est largement disponible et que le besoin de méthodes pour analyser ces données augmente. Cependant, nous oublions parfois que les technologies expérimentales évoluent à une vitesse vertigineuse. Ainsi, lorsque nous développons des méthodes, nous devons également tenir compte du type de données qui seront probablement disponibles à l'avenir, sinon nos méthodes seront toujours en retard par rapport aux besoins de la biologie. Pour aller encore plus loin, je pense que l'analyse des données n'est pas la seule tâche d'un bioinformaticien. Nous devons également contribuer à déterminer quelles données sont nécessaires pour résoudre les questions biologiques en suspens. Cela implique que nous devons nous impliquer activement dans le développement des technologies expérimentales ou, à tout le moins, veiller à entretenir de très bonnes relations avec les personnes qui travaillent dans ce domaine.