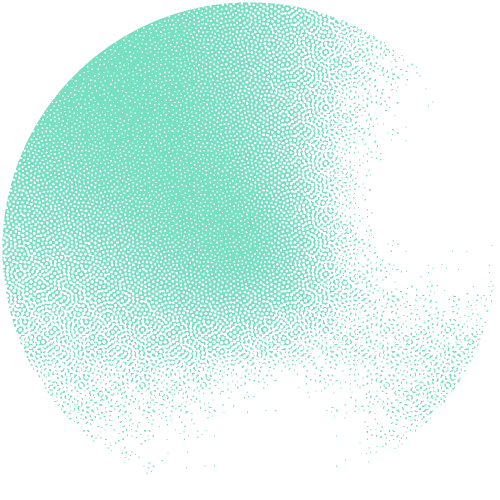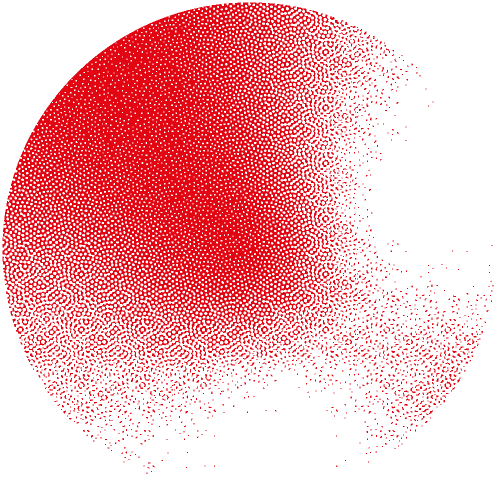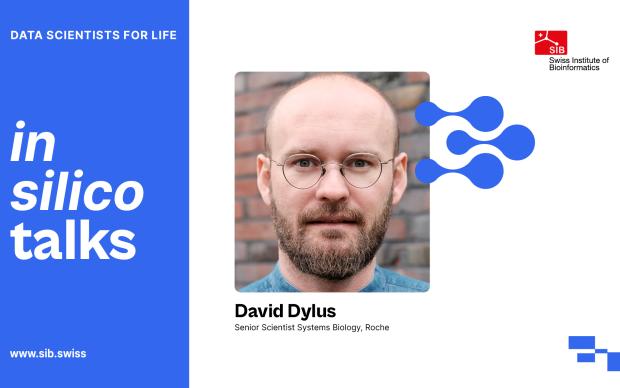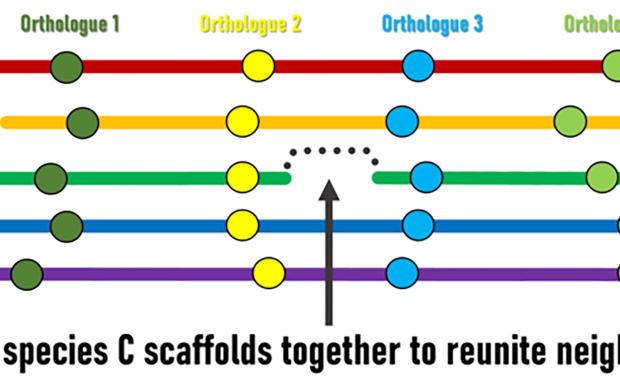Anamaria Necsulea – Lauréate du Prix SIB 2013 pour les bioinformaticiens en début de carrière
Anamaria a reçu ce prix pour ses recherches sur « L'évolution des transcriptomes des tissus vertébrés » (Brawand, Soumillon, Necsulea et al., 2011 et Necsulea et al., 2014), qu'elle a menées dans le cadre de son travail postdoctoral à l'Université de Lausanne, au sein de l'équipe de l'ancien responsable de groupe SIB Henrik Kaessmann (aujourd'hui au Centre de biologie moléculaire de l'Université de Heidelberg).
Aujourd'hui, Anamaria occupe un poste de chercheuse titulaire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Lyon, en France, où elle poursuit ses recherches dans le domaine de la génomique évolutive.
À propos des SIB Bioinformatics Awards et de notre série d'entretiens « Rencontre avec les anciens lauréats des SIB Awards »
Lancés en 2008 dans le but de distinguer de jeunes bioinformaticiens en Suisse, les SIB Bioinformatics Awards ont depuis parcouru un long chemin : d'un seul prix national à trois prix différents aujourd'hui, récompensant 1) des bioinformaticiens internationaux en début de carrière (SIB Early Career Bioinformatician Award), 2) l'excellence au sein de la communauté suisse des doctorants (SIB Best Swiss Bioinformatics Graduate Paper Award) et 3) des ressources bioinformatiques innovantes (SIB Bioinformatics Resource Innovation Award). Au fil des ans, 21 prix ont été décernés, récompensant neuf lauréats pour leur début de carrière exceptionnel, dix étudiants diplômés pour l'excellence de leurs publications et deux ressources bioinformatiques pour leur caractère innovant.
En 2019, les SIB Bioinformatics Awards seront décernés pour la10e fois, ce qui sera l'occasion de retrouver les anciens lauréats et de leur demander où ils en sont dans leur carrière : cette interview fait partie d'une série qui vous invite à rencontrer les anciens lauréats des SIB Bioinformatics Awards.
À quel stade de votre carrière étiez-vous lorsque vous avez reçu le prix SIB ? Qu'avez-vous ressenti ? Quel était le principal centre d'intérêt de vos recherches à cette époque ?
J'ai reçu ce prix peu après avoir terminé mon postdoc avec Henrik Kaessmann. Ce fut un sentiment incroyable de recevoir cette marque de reconnaissance de la part du SIB. À l'époque, mes recherches portaient sur l'évolution des transcriptomes chez les vertébrés. J'avais participé aux premières analyses comparatives à grande échelle des modèles d'expression des gènes codant pour des protéines et des répertoires d'ARN non codants longs chez les amniotes (Brawand, Soumillon, Necsulea et al., 2011 et Necsulea et al., 2014). Ces deux études nécessitaient des analyses détaillées d'énormes quantités de données de séquençage du transcriptome et constituaient donc un défi majeur du point de vue de la bioinformatique.
Quels sont vos domaines de recherche actuels ?
Je m'intéresse (toujours) de manière générale à la génomique évolutive. Je me concentre actuellement sur l'évolution des paysages de régulation de l'expression génétique et son lien avec l'évolution des phénotypes chez les vertébrés.
Selon vous, quelle est la découverte la plus fascinante rendue possible par la bioinformatique ?
Il s'agit d'une question difficile qui peut avoir plusieurs réponses. De nos jours, la plupart des questions de recherche en biologie sont abordées en générant et en analysant de vastes quantités de données, grâce à des approches bioinformatiques et biostatistiques. Issu du domaine de la génomique évolutive, je dois mentionner la découverte précoce d'éléments génomiques non codants ultra-conservés, qui sont des séquences d'ADN presque identiques entre des espèces très divergentes telles que l'homme, la souris et le poulet, malgré des centaines de millions d'années d'évolution. Ces éléments ont été mis en évidence par des comparaisons évolutives de séquences génomiques, d'abord pour quelques gènes (Duret et al., 1993), puis à l'échelle du génome (Bejerano et al., 2004). Leur niveau extraordinaire de conservation évolutive est intrigant, car il suggère que les mutations qui perturbent ces séquences sont fortement délétères et sont rapidement éliminées par la sélection purificatrice. Les biologistes moléculaires tentent encore d'élucider les fonctions de ces séquences ultra-conservées, plusieurs années après leur identification initiale grâce à des approches bioinformatiques.
Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre ?
J'ai commencé le vélo pendant mon post-doctorat en Suisse, et j'aime toujours faire des balades sur les routes de montagne dès que j'ai un peu de temps libre.
Un message pour la future génération de bioinformaticiens ?
À mon avis, les bioinformaticiens d'aujourd'hui doivent se concentrer sur deux points essentiels. Le premier est la reproductibilité : lors de la publication de tout type d'analyse, il est primordial de fournir suffisamment d'informations pour que d'autres chercheurs puissent reproduire les résultats. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas pour de nombreuses publications. Le deuxième point (qui n'est pas le moins important) concerne l'énergie requise par les analyses bioinformatiques. Les quantités de données générées par les approches actuelles de la biologie moléculaire continuent d'augmenter de manière exponentielle, et nous ne devons pas oublier que l'analyse de ces données nécessite des ressources informatiques et un temps de calcul considérables, et donc de grandes quantités d'énergie. Nos recherches peuvent donc avoir un impact négatif important sur l'environnement. Pour limiter cet effet, nous devons tous faire de notre mieux pour écrire des logiciels hautement efficaces pour l'analyse des données biologiques. Voici donc deux conseils : optimisez votre code et rendez-le reproductible !