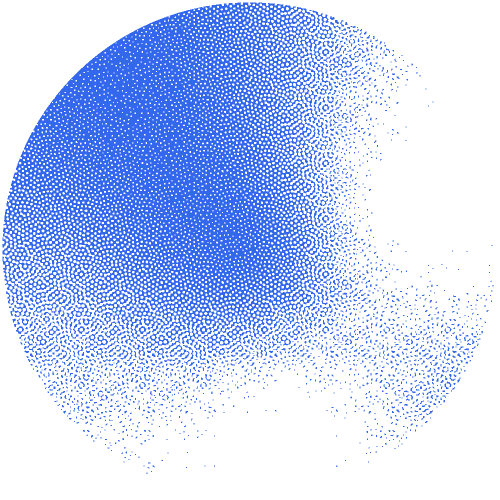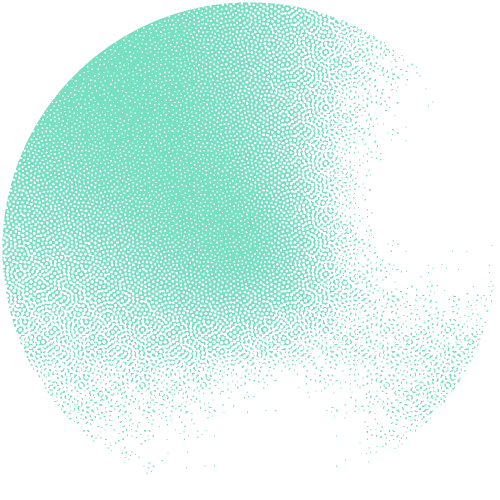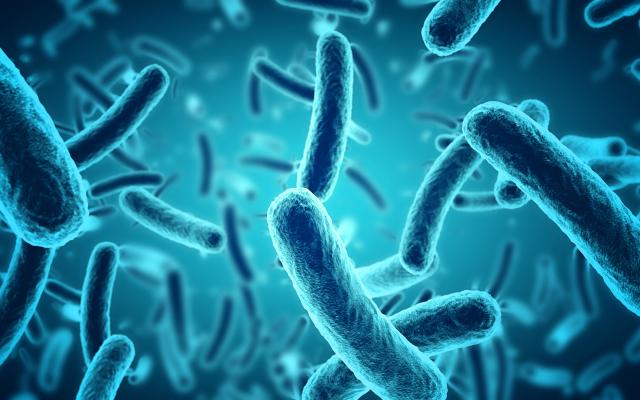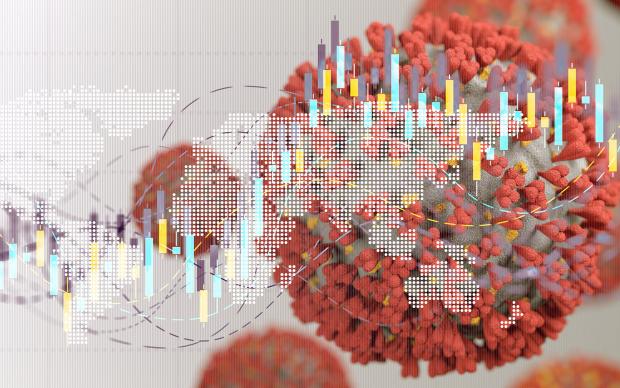La résistance aux antibiotiques est un problème mondial qui ne cesse de s'aggraver. La Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP) est un outil important pour surveiller et contenir les bactéries et virus résistants aux antibiotiques et dangereux. Cette interview réalisée par Alexandra Bucher a été initialement publiée dans le supplément spécial Life Science de la Basler Zeitung du 2 septembre 2022. Elle a été raccourcie et traduite de l'allemand.

Supplément spécial sciences de la vie (02.09.22), par Alexandra Bucher (révisé pour des raisons de longueur et traduit de l'allemand)
La plateforme SPSP met les données génétiques des agents pathogènes à la disposition des chercheurs et des laboratoires en Suisse et dans le monde entier. L'objectif est de mieux comprendre la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques et dangereuses et de les combattre. Aitana Neves est responsable de l'équipe Data Science au SIB et responsable du SPSP. Elle répond avec Adrian Egli aux questions sur la plateforme dans cette interview. Adrian Egli est microbiologiste clinique et dirige l'Institut de microbiologie médicale de l'Université de Zurich. Il est chef de projet et cofondateur de la SPSP.
La résistance aux antibiotiques augmente partout dans le monde. Quelles en sont les raisons ?
Adrian Egli : Les antibiotiques sont largement utilisés en médecine humaine et vétérinaire. Ils peuvent donc s'accumuler dans l'environnement. En raison de leur utilisation généralisée et incontrôlée, les bactéries développent une résistance et reviennent vers l'homme depuis l'environnement et les animaux, notamment via la chaîne alimentaire. Au fil des ans, ce cycle a entraîné une augmentation de la résistance aux antibiotiques.
Vous étudiez également des virus tels que le SARS-CoV-2. Pourquoi ?
Adrian Egli : Heureusement, les virus responsables d'infections respiratoires ne développent pas autant de problèmes de résistance. Mais les virus peuvent rendre les gens très gravement malades. Ce que nous voulons savoir sur les virus, en particulier le SARS-CoV-2, c'est si, par exemple, une nouvelle variante est en train d'apparaître, pour laquelle le vaccin ne serait plus efficace. Grâce à la surveillance, nous pouvons évaluer ce qui circule actuellement et si un vaccin est toujours efficace.
Quels sont les parallèles entre la recherche sur les virus et celle sur les bactéries résistantes aux antibiotiques ?
Aitana Neves : Dans les deux cas, nous déterminons les mutations dans le matériel génétique des micro-organismes en le séquençant. Cela nous permet de retracer le développement du SARS-CoV-2 ou d'une bactérie et de surveiller les chaînes de transmission. Nous comparons différents isolats bactériens ou viraux pour voir s'ils sont apparentés ou non. Nous étudions l'accumulation des mutations au fil du temps. Ensuite, nous nous demandons quels autres facteurs pourraient favoriser la transmission, qu'il s'agisse de l'âge, du sexe ou de la situation géographique, comme l'appartenance cantonale.
Quand, comment et pourquoi avez-vous créé la SPSP ? Qu'est-ce que l'Institut suisse de bioinformatique et quel est son rapport avec la SPSP ?
Aitana Neves : Le SIB est une organisation nationale qui traite des données biologiques et biomédicales. Tous les hôpitaux et laboratoires cliniques peuvent soumettre leurs données de séquençage au SIB, qui dispose de l'expertise nécessaire pour stocker et gérer ces données sensibles. Lorsque nous avons rencontré Adrian Egli il y a plusieurs années, nous avons eu l'idée de créer cette plateforme. C'est ainsi que tout a commencé : nous avons réuni tous les instituts de recherche et le SIB a construit la plateforme.
Comment la plateforme s'est-elle développée depuis lors ?
Adrian Egli : La pandémie de SARS-CoV-2 a certainement donné un coup de pouce à notre plateforme. Nous avons tous pris conscience de l'importance de savoir quelles variantes circulent. À l'origine, nous étions un petit groupe de chercheurs. Pendant la pandémie de coronavirus, d'autres chercheurs et laboratoires nous ont rejoints. Entre-temps, les universités et les hôpitaux universitaires de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, ainsi que de nombreux autres laboratoires cantonaux et privés, ont rejoint le SPSP. Toutes les données de séquençage en Suisse transitent par le SPSP.
Vous soutenez l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) dans le cadre de la pandémie de coronavirus afin de suivre les variants. Quelle forme prend ce soutien ?
Aitana Neves : Depuis juillet 2021, tous les laboratoires privés et publics transmettent leurs séquences au SPSP. Cela aide l'OFSP, qui reçoit et peut ainsi centraliser toutes les informations génétiques sur le SARS-CoV-2. Le SPSP envoie un rapport à l'OFSP trois fois par semaine. Avant cela, nous analysons les données, les standardisons et les mettons sous une forme exploitable par l'OFSP. Ainsi, l'OFSP sait où circulent le virus et ses variants. Il compile ensuite ces données dans son tableau de bord COVID-19, qu'il met régulièrement à jour et rend public.
La SPSP contribue à la science ouverte. Qu'est-ce que cela signifie ?
Aitana Neves : Cela signifie que les chercheurs du monde entier peuvent accéder aux données anonymisées et notamment aux informations génétiques des micro-organismes. Le SPSP s'est montré très actif dans le partage des séquences du COVID-19. La Suisse est ainsi l'un des cinq pays au monde qui fournissent le plus de séquences du SARS-CoV-2 librement accessibles. Cela positionne la Suisse comme un leader international dans ce domaine de recherche et contribue de manière significative à une meilleure compréhension de la propagation des maladies infectieuses.
Regard vers l'avenir : que se passera-t-il si nous ne parvenons pas à éradiquer les bactéries multirésistantes ?
Adrian Egli : J'aime comparer cela au changement climatique. Nous ne le ressentons que progressivement. Mais le changement climatique est une réalité grave qui s'accentue lentement mais sûrement. La résistance aux antibiotiques est également un problème qui s'aggrave lentement. Il est extrêmement important que nous prenions conscience du problème et que nous influencions l'utilisation des antibiotiques. Nous avons besoin d'antibiotiques dans des situations très courantes, par exemple lors d'une césarienne ou lorsqu'une personne contracte une pneumonie pendant une chimiothérapie. De tels traitements ne seront plus possibles lorsque nous serons confrontés à des germes multirésistants.