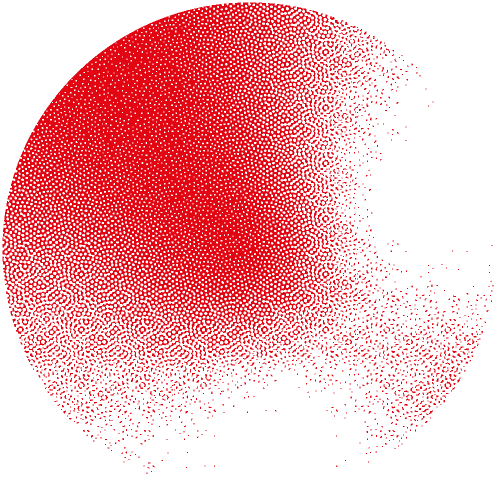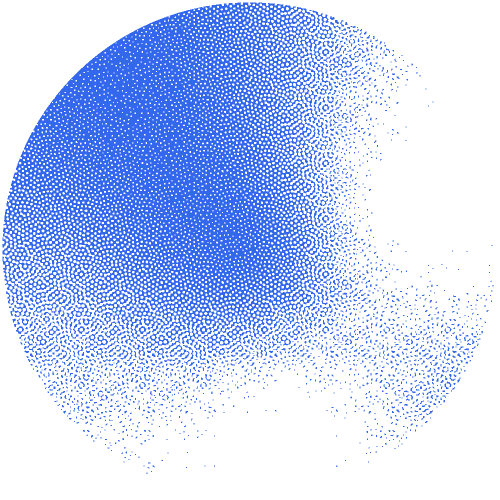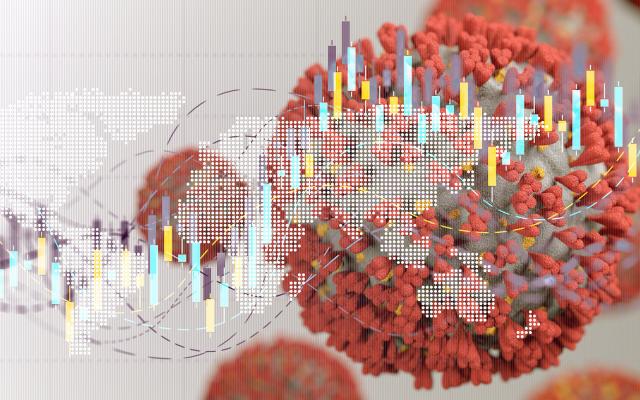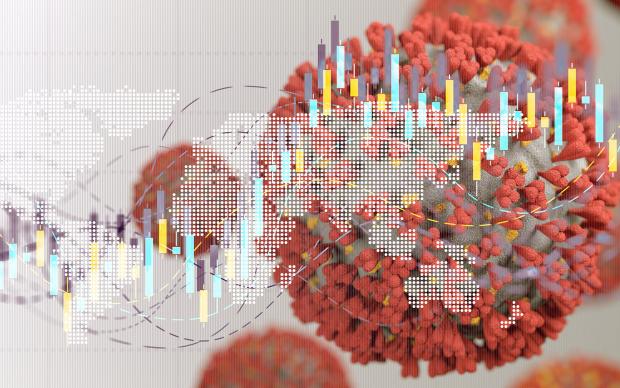Aujourd'hui, le variant delta du virus domine le paysage suisse. Cela n'est possible que grâce à un effort de séquençage sans précédent. Au cœur du processus, une infrastructure nationale, co-dirigée par le SIB Institut Suisse de Bioinformatique, centralise désormais toutes les séquences génétiques du virus collectées en Suisse. D'une part, elle fournit à l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) une vue d'ensemble automatisée de la distribution et de l'émergence des variants dans tout le pays. D'autre part, elle permet le partage rapide et massif des séquences suisses avec les bases de données internationales. La Suisse figure ainsi parmi les plus grands contributeurs mondiaux de séquences du SARS-CoV-2, ce qui accélère la recherche sur les vaccins et les traitements.
À propos de la Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP)
SPSP.ch est une plateforme collaborative suivant l'approche Onehealth, c'est-à-dire multidisciplinaire et visant, entre autres, à optimiser les résultats en matière de santé humaine. Elle est cogérée par le SIB en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Bâle, Lausanne et Genève, ainsi que les Universités de Berne et Zurich (voir la listecomplète des partenaires fournissant des données). Elle est hébergée sur l'infrastructure informatique sécurisée du SIB et respecte les normes de sécurité des données du Swiss Personalised Health Network (SPHN).
La nécessité d'une surveillance coordonnée des variants au niveau national
Alpha hier, Delta aujourd'hui et Mu peut-être demain : la Suisse est à l'affût de l'apparition de nouveaux variants et de leurs chaînes de transmission. Le séquençage du génome du virus permet, à partir d'un test PCR positif, de déterminer l'identité du variant concerné et son profil génétique complet. Rien qu'en août 2021, plus de 5 600 séquences ont été analysées par plus d'une dizaine de laboratoires universitaires ou privés dans toute la Suisse. Mais ces données n'ont de sens que si elles sont mises en relation le plus rapidement possible, d'où la nécessité essentielle d'une coordination et d'une standardisation.
C'est là qu'intervient une infrastructure collaborative et sécurisée co-dirigée par le SIB. Son nom ? La Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP). Son rôle ? Centraliser, harmoniser et annoter les séquences génomiques du SARS-CoV-2 provenant des laboratoires suisses, ainsi que les données qui les accompagnent (date du test PCR, méthode de prélèvement, raison du séquençage, machine utilisée, lieu du test, sexe et âge du patient). Son objectif ? Soutenir la stratégie nationale de surveillance génomique menée conjointement par le Centre de référence national pour les infections virales émergentes (CRIVE) et l'OFSP. La plateforme permet aux autorités de bénéficier d'une vue globale et automatisée du séquençage en Suisse et alimente les bases de données internationales utilisées pour la recherche sur le virus.
« Jusqu'à présent, les séquences que nous avons reçues proviennent de presque tous les cantons suisses : c'est une excellente nouvelle, car cela signifie que les nouveaux variants ont peu de chances de passer inaperçus », explique Aitana Lebrand, responsable de l'équipe Data Science au SIB en charge de la plateforme SPSP.
Accélérer la surveillance de l'épidémie en Suisse
Trois fois par semaine, la plateforme envoie son rapport de surveillance génomique à l'OFSP. L'OFSP l'intègre dans ses statistiques et peut également recouper les informations avec les données dont il dispose sur les hospitalisations, les vaccinations, les symptômes au moment du test, etc. Cela pourrait permettre d'identifier que l'une des mutations observées semble être liée à une plus grande pathogénicité ou à une plus grande résistance aux vaccins.
« Grâce à la plateforme de surveillance développée par le SIB, nous avons accès à une base de données centralisée et standardisée via un point d'entrée unique, plutôt que de recevoir des rapports de chaque laboratoire dans des formats différents », explique Mirjam Mäusezahl, codirectrice de la section épidémiologie de l'OFSP. « Pour nous, cela représente un gain de temps considérable, ainsi qu'une granularité accrue dans l'analyse des données de séquençage. Cela nous permet de concentrer nos efforts sur l'adaptation des politiques de santé publique. »
Stimuler la recherche internationale en facilitant la science ouverte
Grâce au financement du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), la plateforme SPSP transmet également des séquences virales entièrement anonymisées à des plateformes scientifiques ouvertes, telles que le portail européen COVID-19, afin de stimuler la recherche internationale. Grâce à ces efforts, la Suisse se classe actuellement au quatrième rang mondial en termes de nombre de séquences SARS-CoV-2 partagées, derrière le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne. Ces bases de données publiques sont fondamentales pour étudier et comprendre le rôle des variations observées sur la pathogénicité du virus, ses interactions avec les cellules hôtes au moment de l'infection, ainsi que pour le développement de vaccins et de traitements
Et ensuite ? Une application nationale du SPSP, au-delà de la COVID-19
Cette collaboration avec l'OFSP dans le contexte de la pandémie actuelle s'inscrit dans la mission initiale de la plateforme SIB : permettre aux spécialistes d'identifier rapidement l'émergence et la propagation d'agents pathogènes et de prendre des mesures précoces pour enrayer leur transmission en les suivant en temps quasi réel. Avant que le COVID-19 ne modifie les priorités de la recherche, la SPSP ciblait spécifiquement les bactéries multirésistantes. « À l'ère du séquençage, cet outil répond à un besoin essentiel des microbiologistes, qui est de disposer d'une analyse harmonisée et centralisée des profils moléculaires des agents infectieux à l'échelle nationale », commente Adrian Egli, chef du département de bactériologie et mycologie de l'hôpital universitaire de Bâle et co-responsable de la plateforme.
« La possibilité d'utiliser le SPSP à long terme pour relier les données génomiques des bactéries ou virus émergents en Suisse aux données épidémiologiques est prometteuse pour garantir une réactivité exemplaire du pays dans le domaine de la santé publique », conclut Mirjam Mäusezahl.
Lire le communiqué de presse en français et en allemand
Sélection de la couverture médiatique : Le Temps, Heidi.news, RTS La 1ère CQFD, Tages Anzeiger