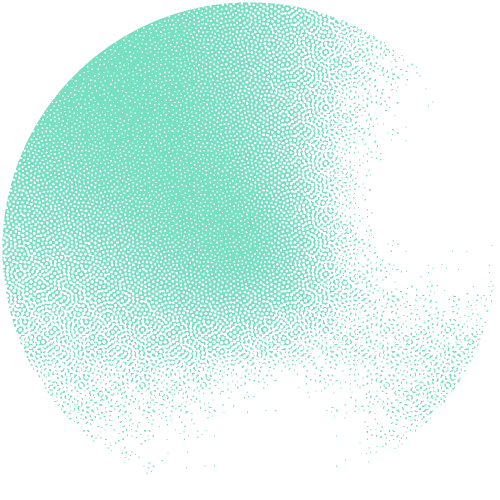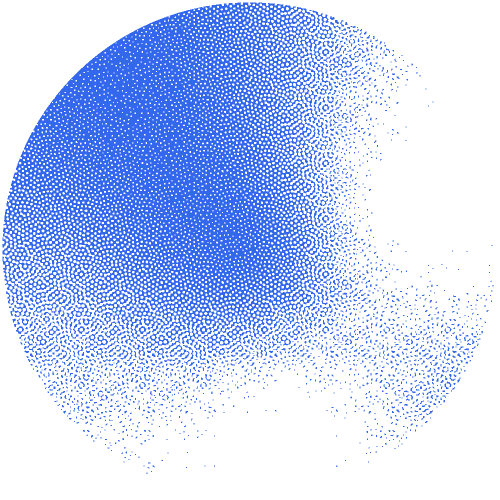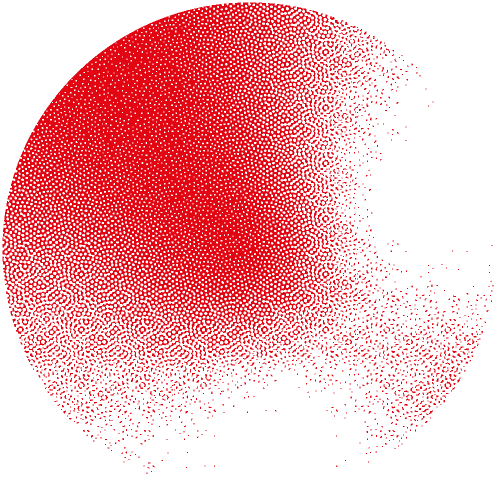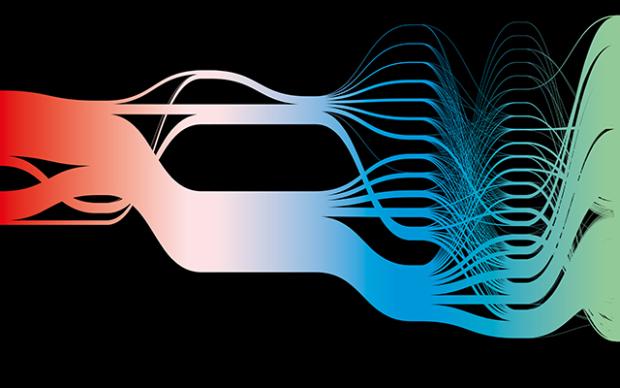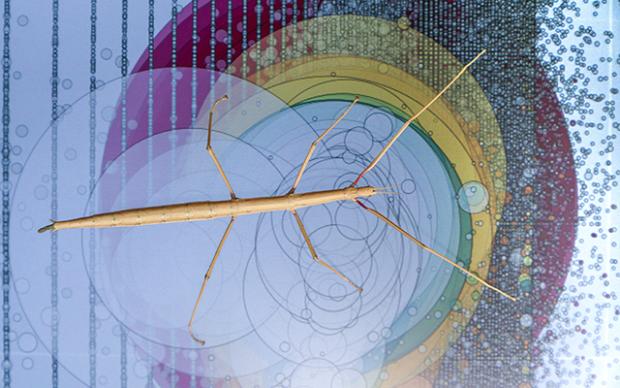Une nouvelle approche statistique publiée dans PNAS permet de détecter la dépression consanguine, c'est-à-dire la perte de fitness et de santé globale due à la consanguinité dans les populations où les individus sont apparentés. Sous la direction du professeur Jérôme Goudet, de l'UNIL et responsable du groupe SIB, les auteurs ont développé un modèle qui peut être utilisé dans un groupe d'individus présentant une forte structure génétique. Une telle structure génétique peut se retrouver chez les espèces menacées comptant peu d'individus, où tous les individus sont apparentés, ou dans des populations mixtes, où des populations isolées se croisent.
La consanguinité et ses conséquences sur la santé
La consanguinité est le résultat de l'accouplement entre parents, ce qui peut entraîner une expression accrue de variantes génétiques nocives, affectant les taux de survie et de reproduction. Elle est souvent associée à un état de santé compromis, un phénomène appelé dépression consanguine, qui a été observé chez de nombreuses espèces différentes, des humains aux animaux en passant par les plantes. La mesure de la consanguinité et de ses conséquences sur la santé est essentielle dans de nombreux domaines de la biologie, notamment la préservation de la biodiversité et des espèces menacées. Le développement de méthodes statistiques et informatiques permettant de le faire avec précision fait partie des diverses activités du SIB dans le domaine de la biodiversité.
Surmonter les préjugés connus
La méthode traditionnelle de mesure de la dépression consanguine fonctionne bien pour les populations importantes et homogènes, où les individus ne sont généralement pas apparentés, comme c'est le cas pour notre propre espèce, où les pays fonctionnent principalement comme une grande cohorte d'individus. Cependant, dans les groupes où les individus sont apparentés à des degrés divers, cela pourrait conduire à une estimation biaisée de l'intensité de la dépression consanguine. Dans cette étude, afin de surmonter ce biais, les auteurs comparent l'approche classique du modèle de régression linéaire à un modèle mixte qui tient compte de la structure de la population en incluant le degré de parenté entre les individus estimé à partir de données génomiques individuelles.pour Jérôme Goudet, responsable du groupe SIB et professeur associé à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, cette méthode innovante permet désormais « d'évaluer les effets néfastes de la consanguinité là où cela est le plus nécessaire, dans les petites populations d'espèces menacées d'extinction »
La consanguinité et ses conséquences sur la santé
La consanguinité est le résultat de l'accouplement entre parents, ce qui peut entraîner une expression accrue de variantes génétiques nocives, affectant les taux de survie et de reproduction. Elle est souvent associée à un état de santé compromis, un phénomène appelé dépression consanguine, qui a été observé chez de nombreuses espèces différentes, des humains aux animaux en passant par les plantes. La mesure de la consanguinité et de ses conséquences sur la santé est essentielle dans de nombreux domaines de la biologie, notamment la préservation de la biodiversité et des espèces menacées. Le développement de méthodes statistiques et informatiques permettant de le faire avec précision fait partie des diverses activités du SIB dans le domaine de la biodiversité.
À partir des données du projet 1 000 génomes
Afin d'étendre leurs conclusions à des échantillons plus petits et à des populations plus structurées, telles que les espèces sauvages et menacées, les auteurs ont simulé des traits à l'aide de données empiriques issues de la phase 3 du projet 1 000 Genomes.
En faisant varier la taille et l'homogénéité des groupes, les auteurs ont pu comparer l'efficacité de leur méthode pour différents sous-échantillons. Ils ont ensuite testé leur modèle sur un ensemble de données empiriques provenant de moineaux domestiques trouvés dans un archipel isolé du nord-ouest de la Norvège. Ils ont pu montrer que leur approche est plus précise que le modèle classique.pour Eléonore Lavanchy, doctorante au sein du groupe Génétique des populations et génomique et première auteure de l'étude « Detecting inbreeding depression in structured populations », les résultats montrent « que la méthode fonctionne pour les très petites populations contenant de nombreux individus apparentés ainsi que pour les populations isolées, qui sont de plus en plus courantes en raison de la crise de la biodiversité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et où il est crucial d'évaluer le statut de consanguinité des individus et ses effets néfastes »
Reference(s)
Légende de l'image : Les données phénotypiques et génotypiques de moineaux domestiques adultes ont été utilisées pour illustrer la méthode. (Joshua J. Cotton / unsplash)